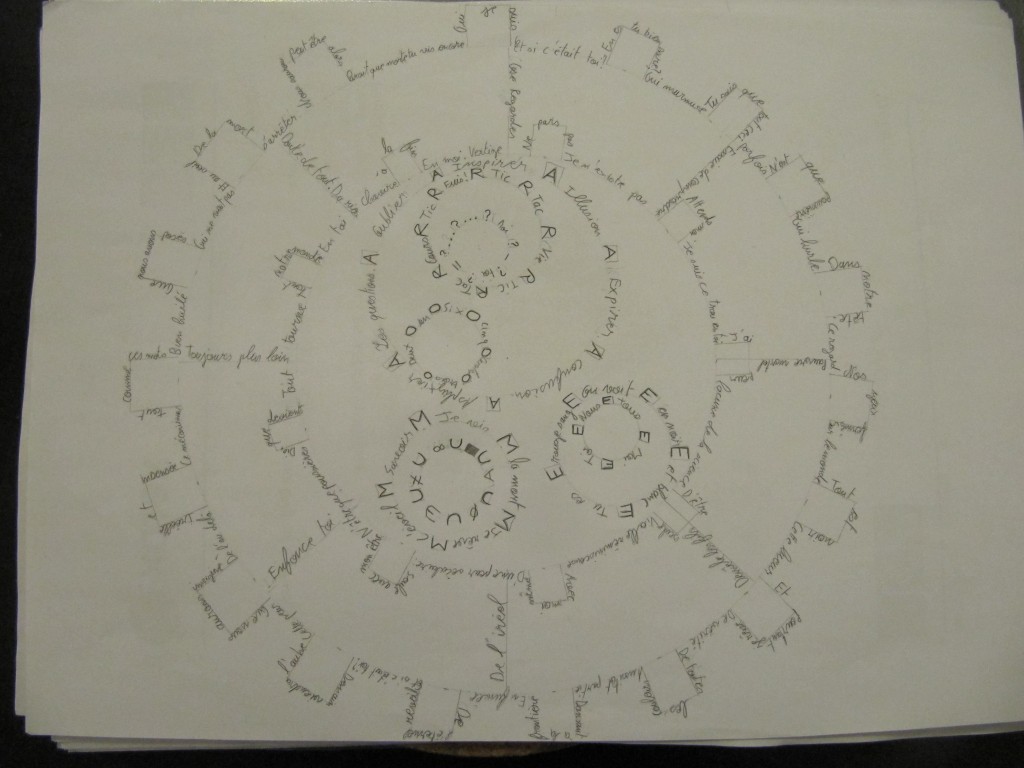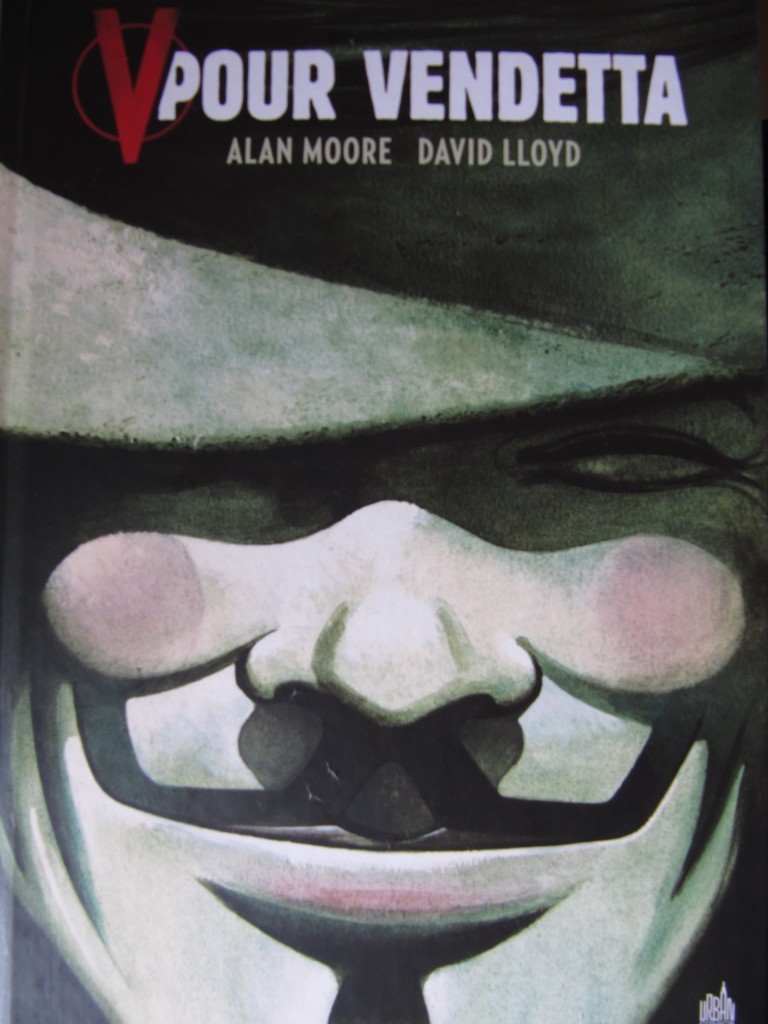Salut !
Oula, cela fait longtemps que je n’ai pas posté ! J’en suis même venue à oublier le dernier texte posté ! Et notamment qu’il devait y avoir une deuxième partie. Je vous la présente donc aujourd’hui, en espérant que vous vous souviendrez du début (ou que vous aurez la force de le relire).
Les lumières de l’automne (1/2)
Bye et bonne lecture !
_______________________________________
Les lumières de l’automne (2/2)
Il est des révolutions contre lesquelles il semble qu’on ne puisse rien faire. Toutes leurs pensées étaient rivées sur la destruction de la ville et il se retrouvait seul sur son muret face à la folie d’un peuple. Sa main errait doucement sur la pierre et s’agrippait parfois à son extrémité comme on resserre sa main sur le bras d’un être cher pour exprimer tous les mots que les lèvres assiègent. Il regardait les Hommes pointer leurs fusils sur les immeubles et ses nuits s’emplissaient petit à petit des cris des habitants rongés par le remord, de tous ces habitants qui se réveillaient le matin le visage creusé de cernes, incapables de chasser de leurs rêves l’ombre de la ville. C’était une guerre sans trêve, l’expression physique d’une révolution interne.
Lorsque l’enfant avait compris que leur objectif n’était autre que l’anéantissement de la cité il avait cherché à la protéger par tous les moyens. Ses petits doigts tiraient sur les manches des habitants pour leur demander d’arrêter mais ils ne remarquaient même pas les larmes dans ses yeux. Toutes les guerres devraient prendre fin par la simple requête d’un enfant en pleurs.
Un jour, ramassant sur le sol les pierres encore en état il tenta de rebâtir le mur de la cour de l’école. Je me souviens de ces briques : elles étaient rouges, un rouge un peu fané recouvert de poussière. Une à une il avait empilé les briques, les époussetant préalablement du bout de sa manche. Puis, tandis que sur la pointe des pieds il tentait de déposer une dernière pierre, la rumeur de la foule s’était faite entendre dans son dos. Sans même avoir eu le temps de s’écarter il avait été projeté au sol, invisible dans les yeux des fous, et avait tout juste pu relever la tête avant de voir son mur s’effondrer comme un château de cartes, comme un coquelicot aux fragiles pétales. Ce jour là un dessin apparu aux côtés des pierres fanées, premier d’une longue série.
Si les habitants souhaitaient ensevelir leurs souvenirs sous la poussière, lui espérait pouvoir rendre éternelle celle qu’il aimait. Mais il semblait que ses dessins, jamais, ne ramèneraient la ville à la vie.
Je me suis souvent demandé ce que les habitants pouvaient voir dans les murs de la ville et quels pêchés ils avaient pu commettre pour être ainsi assailli de remords. J’ai tenté d’en inventer, de bâtir de toute pièce les pires crimes imaginables. Toutefois j’ai vite abandonné : on ne peut inventer ce qui existe déjà. Il me suffisait de fermer les yeux pour voir se dessiner les Hommes adossés au mur, attendant l’impact de la balle ; les femmes que l’on plaquait contre la pierre pour mieux les violer et ces enfants se roulant en boule contre les briques pour se protéger des coups. Je revois ce mur de la cour de récréation contre lequel je m’adossais, espérant que cette fois personne ne viendrait me blesser de ses mots ; les murs des couloirs que je rasais et dans lesquels j’aurais aimé me fondre pour disparaitre aux yeux des autres et tous ceux que j’avais frappé, violence que plus rien ne maîtrise. Personne n’a envie de revenir sur les lieux de ses crimes, alors comment faire lorsqu’on vit dedans ?
Peut-être qu’au milieu de ces milliers de personnes rongés par le remord, certains souhaitaient simplement voir disparaître la cité pour ne plus fouler tous les jours ces lieux marqués par leurs larmes. Si la ville avait été de fer, je crois qu’elle serait désormais couleur de rouille.

Une légende raconte qu’un enfant serait un jour venu se perdre dans les rues de la ville. Il aurait toqué à la porte massive de l’enceinte que nul jamais ne franchit et elle lui aurait ouvert son cœur.
Parfois, assis sur le rebord d’un muret ou d’un trottoir, indifférent à l’agitation alentour et au jour décroissant, certains le surprenaient à remuer les lèvres sans pouvoir entendre les mots qu’il murmurait, souvenirs d’enfance dont seules les images subsistent. Quelques uns prétendent qu’il complotait au cœur même de la cité, d’autres qu’il lui récitait des poèmes d’amour pour la séduire. Je crois, moi, qu’il lui racontait simplement sa journée avant de lui dire bonne nuit.
Le regard qu’il portait sur la ville était différent de celui des autres habitants : au lieu de fixer les cicatrices il s’attardait sur l’éclat des yeux, repoussant l’horreur il venait s’accroupir près d’un sourire. Il la trouvait belle comme elle était, avec ses vieux cimetières en ruine et ses tours de béton armé. Peut-être parce qu’il s’endormait tous les soirs au creux de ses bras ou parce qu’il apercevait, au travers de la muraille, les champs de blé passés. Peut-être parce qu’il avait trop d’espoir pour s’arrêter aux erreurs de l’humanité.
Petite je disais toujours que je n’aimais pas la ville et que je voulais vivre à la campagne. Je n’aimais pas ces murs m’emprisonnant alors que je ne demandais qu’à courir, libre, dans les prairies. Je n’aimais pas ces rues emplies du bruit de la foule et de celui des voitures masquant le chant des oiseaux et le rire du vent dans les arbres. Je ne supportais pas tous ces gens autour de moi qui m’épuisaient, leurs regards qui nous font courber le dos et leurs remarques venant se nicher au creux de nos cœurs pour attendre l’instant où ils pourront germer.
Je détestais la ville mais j’y ai passé les 20 années de ma vie et en passerait encore beaucoup. J’y ai tant de souvenirs…
Petite je fuyais, disparaissant au sein de mes mondes que je peuplais de montagnes et de prairies, de forêts et d’animaux sauvages. Aurais-je détruit les villes si j’avais pu ? Aurais-je détruit ma ville ?
Je ne crois pas. On ne peut pas détruire nos souvenirs, on les fuit juste le temps de pouvoir retourner sur les lieux de leurs baptême et leur faire face.
Je n’aurais pas voulu faire disparaitre cet enfant.
C’était l’automne, triste saison qui pleurait. Les habitants avaient fini par abattre jusqu’aux arbres et dans le parc les troncs se mêlaient désormais aux feuilles mortes. Leur écorce humide commençait à se recouvrir de mousse et leurs branches alignées sur le sol semblaient vouloir ramasser les souvenirs envolés. Assis au sommet d’un des derniers arbres encore debout, un enfant dessinait. Il dessinait chaque feuille que les baisers du temps avaient rougis et leurs reflets sang dans les flaques d’eau, ces feuilles que les habitants avaient froissé, piétiné, déchiré. Il dessinait un rêve qui s’effritait déjà dans les mémoires comme on pose sur papier nos mondes nocturnes, comme on ferme les yeux pour se repasser les instants de nos vie que l’on se refuse d’oublier. Alors, juché en équilibre précaire sur sa branche, les yeux rivés sur un présent fané, l’enfant ne vit pas qu’un homme s’approchait, une hache à la main. Il ne vit pas l’acier se planter dans le bois à en faire vaciller l’arbre et aperçut seulement le monde qui soudain chavirait. Peut-être aurait-il pu se raccrocher à une branche s’il avait lâché son carnet de croquis mais cette idée ne l’avait même pas effleuré : il ne voulait pas perdre la ville une deuxième fois.
Ce jour là un homme vit 1m47 d’espoir tomber de l’arbre, sa hache à la main. Il vit une luciole battre des ailes avant de chuter, un petit bout de lumière s’enfoncer dans l’obscurité. Comme tous les habitants il avait participé à la destruction de la cité, jamais il n’avait hésité. Cependant, en cet instant précis, il sut que s’il ne lâchait pas son arme, s’il ne tendait pas les bras pour rattraper l’enfant alors sa vie n’aurait plus aucun sens. Ce petit garçon lui était complètement inconnu mais il dut sentir que son salut se trouvait peut-être en lui et qu’il n’avait pas le droit de laisser s’éteindre le dernier être qui, dans cette ville, n’était pas tâché de rouge.
Ce jour là, au beau milieu d’une cité à feu et à sang, deux mains en coupe se joignirent pour sauver une petite luciole de l’oubli. C’était l’automne sur la ville.
Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d’aussi petit pouvait percer des ténèbres aussi profondes que la nuit ? Pourquoi notre regard se raccroche désespérément à ce point de lumière vacillante et semble encore plus perdu lorsqu’il disparait ?
Ce que j’aime le plus dans les lucioles ce sont ces instants où elles s’éteignent et où on part à la recherche de l’endroit où elles réapparaitront, notre cœur expérimentant sans cesse la joie de la naissance de la lumière.

![]()